
Quand les rêves des parents deviennent le poids invisible des enfants.
L’illusion de l’enfant-idéal, et ses conséquences à l’âge adulte
Beaucoup d’adultes vivent aujourd’hui une vie estimée réussie sur le papier.
Ils ont coché les bonnes cases, suivi le bon parcours, obtenu la reconnaissance attendue. Et pourtant, ils ressentent un vide diffus, une impression d’être à côté de soi-même, de ne pas être tout à fait chez soi dans sa propre vie.
Cette sensation, souvent incomprise, peut prendre racine dans un phénomène psychique ancien :
La projection parentale et la construction inconsciente de l’enfant-idéal.
Le rêve parental : un moteur… ou un piège ?
Tous les parents veulent « le meilleur » pour leurs enfants. Mais ce « meilleur » est souvent défini à partir de leurs propres désirs non réalisés, de leurs échecs, de leurs blessures. L’enfant devient alors, inconsciemment, un vecteur de réparation narcissique : il doit réussir là où ses parents ont échoué, incarner ce qu’ils n’ont pas pu devenir.On ne le dit pas toujours. Mais on le pense, on le projette. Et l’enfant,par loyauté affective, absorbe cette mission invisible.
Le psychanalyste Jacques Lacan parlait de l’enfant comme « symptôme du couple parental« . Il n’est pas seulement accueilli pour lui-même, mais pour ce qu’il vient signifier, porter ou résoudre.
Deux réactions majeures chez l’enfant
Sous l’ombre pesante des attentes familiales, le Moi de l’enfant cherche à se frayer un chemin. Comme un funambule, il oscille entre la fidélité à l’idéal imposé et l’appel de la liberté. Certains s’y accrochent avec ferveur, assoiffés de reconnaissance, jusqu’à se perdre dans le reflet des autres. D’autres s’en détachent avec fracas, brisant les chaînes au risque de se perdre dans le vertige d’une identité sans ancrage.
Deux réactions majeures chez l’enfant
Sous l’ombre pesante des attentes familiales, le Moi de l’enfant cherche à se frayer un chemin. Comme un funambule, il oscille entre la fidélité à l’idéal imposé et l’appel de la liberté. Certains s’y accrochent avec ferveur, assoiffés de reconnaissance, jusqu’à se perdre dans le reflet des autres. D’autres s’en détachent avec fracas, brisant les chaînes au risque de se perdre dans le vertige d’une identité sans ancrage.
Face à ces attentes silencieuses, les enfants développent souvent l’une de ces deux postures :
- La sur-adaptation : ils excellent, brillent, réussissent. Mais en réalité, ils incarnent une image idéalisée, au prix de leur propre désir.
- La rébellion : ils refusent les injonctions, parfois de manière brutale ou autodestructrice, simplement pour affirmer leur liberté.
- Dans les deux cas, l’enfant se décentre de lui-même. Il devient le reflet d’un autre.
Et à l’âge adulte ? Le sentiment d’aliénation douce.
De nombreuses personnes entrent en thérapie ou en questionnement profond avec cette phrase en tête :
« Je ne sais plus qui je suis, ni pourquoi je fais ce que je fais.«
Elles ont tout pour être « heureuses », mais elles sentent qu’elles ne sont pas à la bonne place. Elles ont « réussi », mais sans adhésion intime. Ce sont souvent des enfants devenus adultes ayant vécu selon un idéal transmis, et non choisi.
Cette situation, bien connue en psychanalyse, touche autant la sphère personnelle que professionnelle : orientation scolaire dictée, carrières imposées, schémas affectifs répétés…
Se libérer sans accuser : le travail d’individuation
Le travail thérapeutique ou introspectif consiste alors à faire la distinction entre :
- Ce qui a été hérité (désirs, attentes, schémas familiaux)
- Et ce qui est authentiquement personnel (valeurs, élans, projets, vocation).
Il ne s’agit pas de rejeter ses parents, ni de blâmer leur amour, mais de reprendre le fil de sa propre narration, en conscience.
Comme le dit Winnicott : « Le rôle du parent, c’est de permettre à l’enfant de devenir ce qu’il est. »
Pourquoi ce thème a-t-il toute sa légitimité au sein des structures et institutions ?
Parce qu’il exerce une influence tangible sur la vie professionnelle. Le narcissisme parental, tel une empreinte indélébile, s’inscrit dans l’histoire psychique de l’individu. Ses résonances se déploient dans l’exercice du leadership, nourrissent ou inhibent les vocations, orientent les choix de carrière et façonnent la confiance en soi.
Par exemple, un manager ou un dirigeant peut agir selon un scénario parental non digéré et inconsciemment reproduire des schémas de contrôle, de sur-adaptation ou d’autorité.
Comprendre l’influence des projections familiales, c’est aussi :
- Mieux accompagner les parcours de reconversion
- Identifier les impasses professionnelles
- Libérer les talents cachés
- Et encourager des formes de leadership plus conscientes et véritablement ‘’alignées’’, c’est-à-dire en cohérence avec les valeurs profondes de la personne, ses compétences réelles et ses aspirations authentiques.

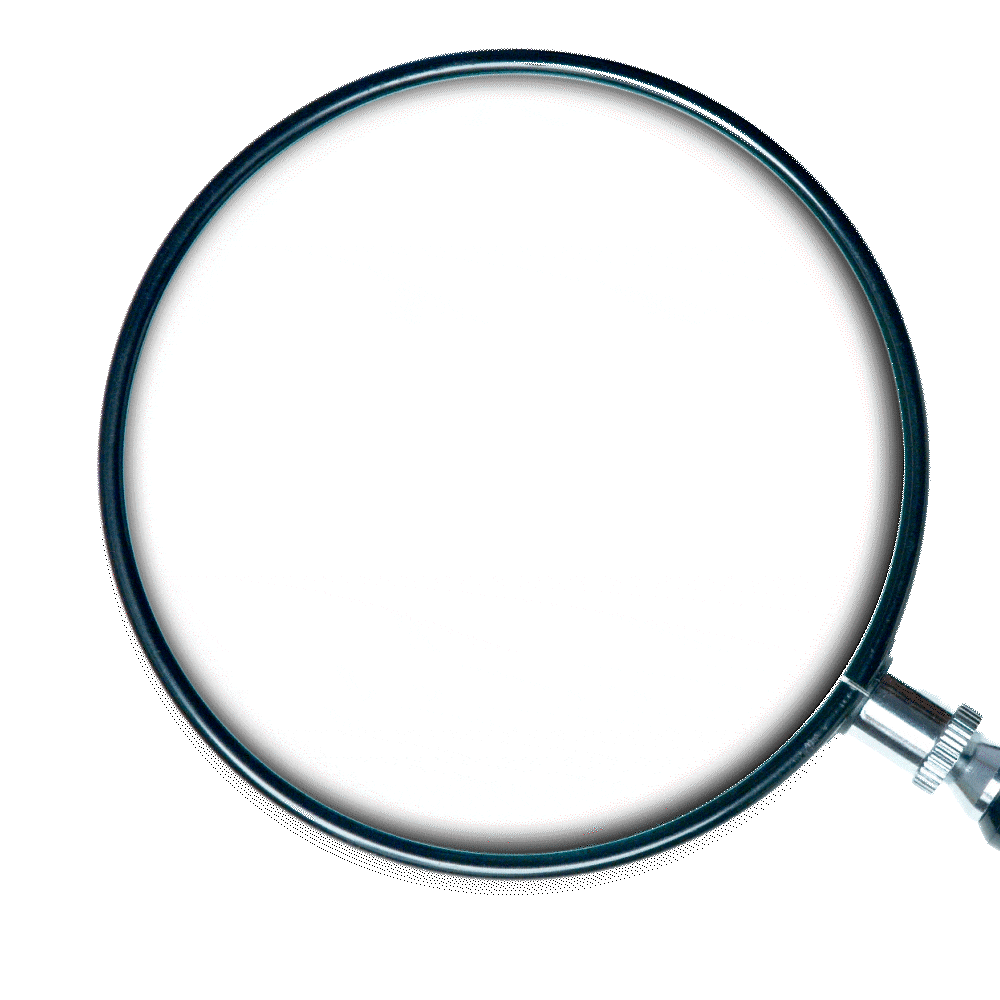
Très bon article.